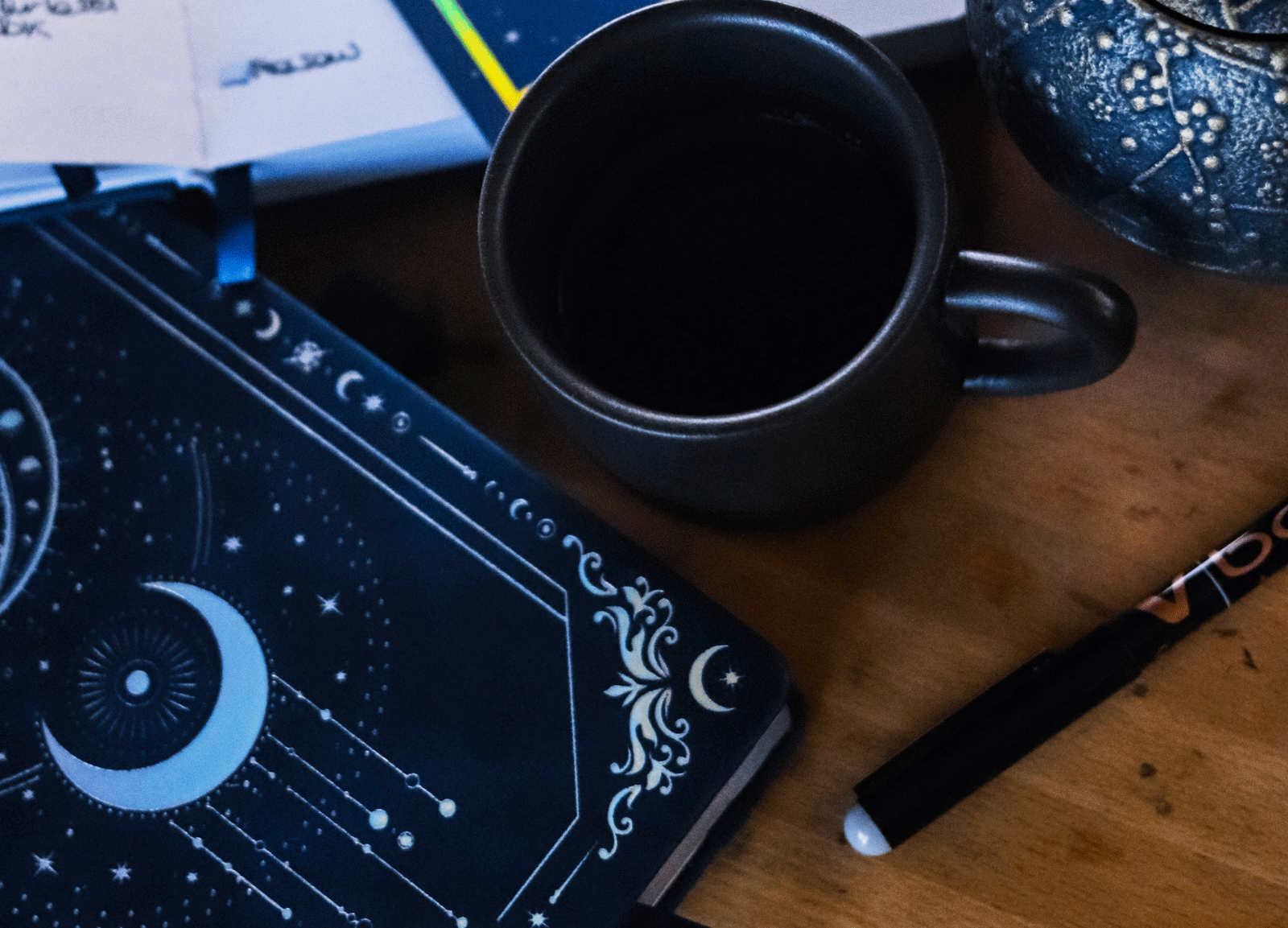L’une des plus grandes difficultés que j’ai eues ces dernières années, en rapport avec mon activité d’écrivaine, c’était d’apprendre à ralentir.
En effet, quand j’écrivais un roman, je le faisais en mode « machine » : j’y consacrais l’entièreté de mes journées, jusqu’à 6 heures par jour, jusqu’à ce que je termine le travail (soit l’écriture du premier jet, soit sa correction). Au début, j’adorais ça puisque j’étais entièrement plongée dans mon texte, au point de manger, dormir, vivre avec mes personnages. Et comme j’écrivais des romans de taille raisonnable, ça allait vite.
Mais avec le temps (et l’âge), j’ai commencé à trouver ça pénible.
- Passer autant de temps assise à mon bureau, devant mon clavier, a bousillé mes épaules. J’enchaîne les problèmes depuis des années : tendinites, capsulites, inflammation acromio-claviculaire. Aujourd’hui je me bats contre une névralgie cervico-brachiale et clairement, j’en ai marre d’avoir mal tout le temps.
- Le mode « machine » m’empêche de travailler sur autre chose en parallèle, puisque toute ma journée de travail passe dans l’écriture. Ça fonctionnait quand écrire était mon boulot à temps plein ; ça ne marche plus aujourd’hui, alors que je fabrique des bijoux. Avant (avant quand on ne dépendait pas des réseaux sociaux pour vivre de son travail artisanal), je pouvais prendre trois semaines pour écrire et mettre de côté mon travail bijoutier, mais aujourd’hui ce n’est plus possible.
- La taille de mes romans a considérablement augmenté ces dernières années : mes livres ont triplé de volume. Les écrire prend beaucoup plus de temps qu’avant. Si j’aime toujours autant rester plongée dans mon univers, j’ai beaucoup de mal à me lancer dans l’écriture : les premiers jours, j’ai l’impression qu’une montagne gigantesque se tient devant moi, que je sais que je vais la gravir, mais que cela me prendra deux mois (voire plus). Et ça, je n’y arrive plus.
Le changement, c'est maintenant
La situation n’était plus tenable depuis deux ou trois ans déjà. Ce que je trouve assez ironique finalement, puisque je voulais changer de rythme alors que mon travail était d’écrire. Mais ce n’est pas incompatible : puisque je devais aussi gérer des tas d’autres aspects de mon boulot (la commercialisation, la communication), je trouvais logique de trouver un autre rythme pour l’écriture, histoire de ne plus bosser « par à-coups ».
Je n’ai pas réussi. Je n’arrivais pas à changer ce foutu rythme. Dès que je tentais, mon cerveau se rebellait et considérait qu’en fait, le mieux serait de boucler au plus vite l’écriture (ou la correction) du livre pour pouvoir passer à autre chose. J’ai donc continué à me plonger dans chaque livre, à en sortir avec des douleurs et à devenir de plus en plus fatiguée de cet effort intellectuel qui était de plus en plus difficile.
Évidemment, quand j’ai décidé de rouvrir ma boutique de bijoux cet été, il a fallu trouver une solution. Parce que les temps ont changé, par rapport à avant : je ne pouvais plus gérer cette boutique comme je le faisais, sortir des bijoux quand l’inspiration me venait, communiquer sur les RS comme j’en avais envie et disparaître pendant trois semaines pour écrire.
Non, je devais trouver un autre rythme, à tout prix, en gardant à l’esprit que la communication allait prendre beaucoup d’espace (exactement comme pour les livres, d’ailleurs. Au moins, ça, je l’avais assimilé depuis longtemps). Il fallait gérer l’expédition des commandes, la création des bijoux, leur mise en vente et la com, ce qui allait devenir compliqué pour écrire. La seule solution, c’était de réserver un petit créneau dans la journée pour mes livres, et ce tous les jours.
J’ai réussi, contre toute attente. Je suis même étonnée de la facilité avec laquelle je me suis glissée dans ce nouveau rythme, mais peut-être parce que je n’avais pas le choix. Si je voulais continuer d’écrire mes histoires, je devais accepter ce changement.
Un rendez-vous en tête-à-tête
Le créneau choisi était celui du soir : entre 22h et 23h, parfois un peu plus tôt. Je ne me suis pas laissé le choix, je me suis obligée à écrire tous les jours durant cette heure, même quand je n’en avais pas envie, et je m’obligeais à ne rien prévoir d’autre à la place. En y réfléchissant, sur les quatre mois de rédaction du roman en question, j’ai dû rater le coche trois ou quatre fois seulement (parce que j’étais absente, parce que j’ai eu une journée crevante, parce que j’avais la flemme aussi) (se donner le droit d’avoir la flemme de temps en temps, quand c’est rare, c’est bien).
Alors oui, écrire seulement une heure par jour, en regard des cinq heures en moyenne de ces dernières années, ça rend la rédaction du roman beaucoup plus longue. Mais ça reste gérable puisqu’il ne s’agit que d’une heure. Quand on se pose devant son clavier avec la perspective d’y rester cinq heures, c’est difficile et décourageant ; quand il ne s’agit que d’une heure, c’est beaucoup plus simple.
Après, n’allez pas croire que j’étais motivée tous les jours. Je ne l’étais quasiment jamais. Mais si vous croyez qu’un auteur (ou un artiste) est motivé chaque jour que Dieu fait pour réaliser son travail, vous croyez à des idées reçues : la motivation et l’inspiration n’entrent jamais (ou presque) en lignes de compte là-dedans. Le secret, c’est juste de travailler, d’avancer, de ne jamais lâcher.
Mais ça restait agréable. J’aimais beaucoup me mettre dans le canapé, le soir, en pyjama, avec mon plaid sur les genoux et ma musique dans les oreilles, la vue sur la ville dans le noir par la grande fenêtre face à moi. C’était mon rendez-vous avec moi-même.
Une nouveauté
Et si ça a été si simple (pas facile, attention, simple), c’est parce que j’ai changé les règles : j’ai écrit mon roman à la main.
Avant, il y a longtemps, quand j’écrivais un peu mais pas de façon sérieuse, j’écrivais à la main. J’ai écrit le début des premières versions du Temps des cendres par exemple, ou les nouvelles du Rêve du Prunellier, mon premier recueil. Et c’est peut-être pour ça que je n’arrivais pas à finir, car je me souviens avoir pu terminer mes textes dès lors que je les écrivais sur ordinateur.
Écrire sur ordi, c’est le meilleur moyen de savoir où on va : j’ai mes habitudes, je sais combien de pages font mes chapitres, d’un coup d’œil j’évalue la longueur, on peut facilement remonter en arrière pour relire un truc ou corriger. J’évite toutefois de corriger pendant la phase d’écriture, sauf gros changement narratif, de structure, etc, parce que ça me permet de remettre mes idées en place si je suis perdue. Mais sinon, je ne relis jamais mes textes et je ne les retouche pas.
J’ai quand même voulu tenter d’écrire à la main, car tant qu’à apporter du changement dans mon écriture, autant y aller à fond. J’ai acheté des carnets (les trois mêmes), et je me suis lancée. J’ai été surprise de la facilité avec laquelle ça s’est fait !
Au début, bien sûr, la nouveauté fait qu’on est motivé. Ça changeait, d’écrire dans un carnet, dans le canapé, une heure par soir. Après, la démotivation a commencé à s’en ressentir mais en fin de compte, c’est toujours le cas, j’ai toujours un moment de démotivation quand je travaille sur un roman ; ensuite, je prends ma vitesse de croisière et l’écriture devient une habitude ; et sur la fin, il est temps que ça se finisse, car il y en a marre.
Mais ça s’est fait tranquillement, à son rythme. Je voyais mes carnets se remplir et j’étais contente quand j’en terminais un : à chaque fois, je notais le numéro sur le dos du carnet, puis je le rangeais dans la bibliothèque. C’était une jolie motivation.
Petit point matos
Les carnets utilisés sont des carnets achetés chez Tiefossi, qui est une boutique qui propose de très beaux carnets (attention toutefois car ils viennent de Chine). J’en avais déjà un de chez eux que j’utilisais pour mon bullet journal, avec un papier très épais et un quadrillage « points ». Ceux que j’ai choisis pour le roman ont un papier plus fin (100 gr) et ligné, qui laisse un peu transparaître l’encre mais ce n’est pas trop grave puisque le papier était parfait pour moi (j’aime bien quand ça absorbe un peu). Sans compter qu’il y a beaucoup de pages dedans, et il en fallait pour contenir un de mes romans.
Par contre, j’ai usé un nombre incalculable de stylos, ce qui m’a fait me rendre compte de la consommation de plastique que représentent les stylos. Mes stylos préférés sont les Hi-Tecpoint V10 Grip de chez Pilot. La pointe est archi-large, l’encre glisse toute seule sur le papier, c’est un plaisir absolu d’écrire avec ces stylos, et pas seulement des romans. Sauf que j’ai réalisé qu’ils avaient une durée de vie très limitée et j’en ai jeté un peu moins d’une dizaine avant de me rabattre sur autre chose. J’ai essayé les stylos plume : sympas, mais je ne vais pas en acheter d’autres et ceux que j’ai à la maison (des Parker) me faisaient mal à la main. Finalement, j’ai essayé les feutres et j’y ai trouvé mon compte avec un Tombow Dual Brush qui a tenu longtemps (et qui est toujours en vie) et qui, cerise sur le gâteau, ne causait aucune douleur.
J’ai terminé d’écrire mon tome 3 pile le jour de l’ouverture de ma boutique, ce que je trouvais plutôt symbolique puisque j’ai commencé à l’écrire au moment où je décidais que l’écriture à temps plein était finie pour moi. Il a fallu quatre mois pour terminer le premier jet. Ce fut long, mais pas tant que ça. En vrai, ce qui m’ennuyait le plus, c’était que je n’allais plus pouvoir sortir deux romans par an comme je le faisais avant : il ne fallait pas oublier le temps de révision du texte, sa correction, et cela devait aussi se faire à raison d’une heure par soir.
Résultat, après recopiage, le roman fait 900 000 signes, soit un petit pavé. Mes carnets font environ 316 pages, et il y en avait trois, donc.
Ah, et puisque je sais qu’on va me poser la question : il s’agit d’un premier jet, donc oui, le carnet est raturé, abîmé, les phrases sont loin d’être définitives. C’est un brouillon ! Ce manuscrit n’est pas fait pour être lu, c’est juste la base sur laquelle travailler ensuite, pour parfaire le texte. Si vous regardez les manuscrits des grands auteurs comme Baudelaire ou Balzac, vous verrez qu’ils n’étaient pas très regardants sur la lisibilité de leurs écrits.
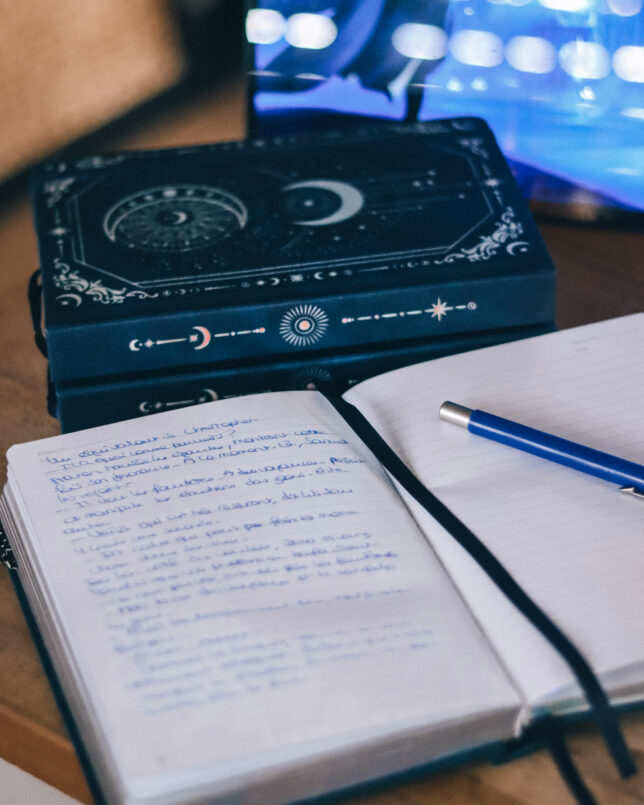
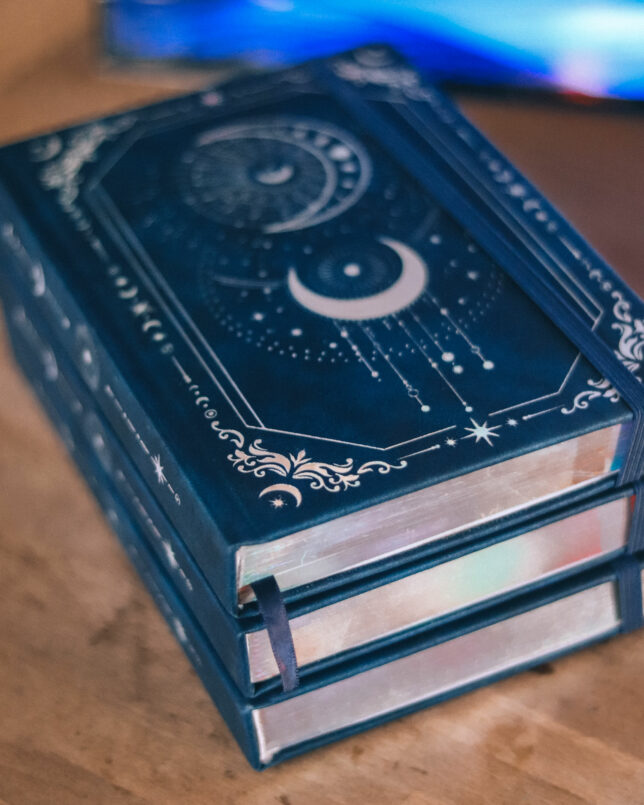
Le bilan
De cette expérience, je retiens donc :
- le fait d’avoir ce rendez-vous avez soi-même, loin de l’ordinateur.
- la fierté d’avoir enfin réussi à changer de rythme, et de faire de l’écriture une habitude quotidienne (comme de nombreux auteurs), là où avant j’avais deux ou trois périodes d’écriture par à-coups chaque année.
- la satisfaction de voir que je n’écrivais pas « plus mal » que sur ordi : la manière d’écrire change, puisqu’à la main, on ne voit pas sa phrase se dérouler en entier devant soi (surtout quand on a une écriture merdique comme moi). Mais j’ai l’habitude de ce changement de « support » puisque j’ai appris à dicter il y a quelques années, j’ai écrit des romans en les dictant et j’ai dû reprogrammer mon cerveau pour ça. Je savais déjà comment faire, donc.
- le bonheur d’avoir un manuscrit papier à l’arrivée ! J’adore voir les trois carnets dans la bibliothèque des carnets qui renferment mes projets (j’avais gardé pendant longtemps les cahiers dans lesquels j’avais écrit mes premiers textes, mais j’ai tout mis à la poubelle pour faire de la place).
Il y a aussi quelques points négatifs :
- écrire à la main fait mal : à la main, au poignet, à l’épaule, et également aux cervicales (puisqu’on a la tête penchée). J’ai dû alterner, parfois, et écrire dans le canapé et à mon bureau. Si les cervicales me font toujours mal, la main et le poignet ont récupéré
- le petit plaisir de comptabiliser le nombre de signes écrits à la fin de chaque séance n’existe pas, puisqu’il n’y a pas moyen de les compter sur papier. OK, ce n’est qu’un détail mais ça m’a un peu manqué.
- il faut recopier sur ordi, après.
Ce dernier point est celui qui pourrait me dissuader de recommencer pour mon prochain roman, car j’ai beau retourner le problème dans tous les sens, je n’ai trouvé aucune configuration pour rendre cette étape moins longue.
Au début, je recopiais chaque dimanche ce que j’avais écrit dans la semaine : j’arrivais à tenir le rythme mais j’y passais littéralement ma journée (sans compter qu’à l’époque, j’avais une newsletter à écrire tous les dimanches). Sur la fin, j’ai même laissé tomber le recopiage, et j’ai passé de nombreuses soirées à le faire une fois le premier jet terminé. J’ai dû y passer une quinzaine de jours alors qu’il me restait quelque chose comme un huitième du roman à recopier, ce qui, on est d’accord, est beaucoup trop long.
Je ne sais pas encore comment régler ce problème. Consacrer un jour de plus à ça, en plus du dimanche ? Recopier une fois le premier jet achevé, quitte à y passer deux mois ? Faire comme ma copine Marielle, qui recopie sitôt sa séance d’écriture terminée ? Recopier le lendemain la séance de la veille ? Il y a également la solution de la dictée, mais pour l’avoir pratiquée, donc, je sais que le travail de retouche ensuite est très important, à cause de petits mots de liaison que le programme n’entend pas (et que l’on peut ne jamais voir, même quand on relit plusieurs fois le roman, même avec une correctrice).
Bref, pour le moment je ne sais pas et ça m’ennuie car j’ai adoré tout le reste, mais cette contrainte si importante qu’elle efface le reste.
Voilà pour ce retour d’expérience, donc. Ce fut chouette malgré quelques inconvénients parfois pénibles, et si j’ai très envie de recommencer pour le prochain roman (juste pour avoir un manuscrit papier à la fin), je ne suis pas encore décidée. Je vous dirai ça le moment venu !